Qu’est-ce qui explique le recours – ou non – au dépistage chez les jeunes ? Comment imaginer une prévention ancrée dans les communautés concernées ? Quels sont les ressorts ou les obstacles d’une prévention biomédicale chez les individus qui y sont confrontés ? Quelques questions dont nous donnerons ici un très rapide aperçu, et qui résonnent avec nombre des articles publiés depuis trois ans dans REACTUP.
La plupart du temps dans REACTUP, la prévention est envisagée à partir de résultats de recherches biomédicales : essais d’antirétroviraux en prévention, cohortes de séronégatifs ou de séropositifs incluant des données sur les pratiques sexuelles et/ou de prévention, etc. La conférence sciences sociales et VIH qui s’est déroulée à Paris la semaine dernière (ASSHH 2013), et dont le thème était cette année « Connaître les pratiques », a permis de lancer quelques pistes issues du domaine des sciences sociales. Qu’est-ce qui explique le recours – ou non – au dépistage chez les jeunes ? Comment imaginer une prévention ancrée dans les communautés concernées ? Quels sont les ressorts ou les obstacles d’une prévention biomédicale chez les individus qui y sont confrontés ?
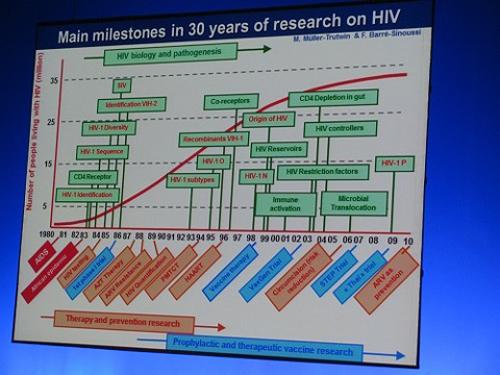
De nombreuses étapes de cette recherche ont nécessité une étude du contexte social de l’épidémie : qui sont les malades ? Qui le devient ? Pourquoi telle stratégie de prévention paraît « adaptée » quand d’autres échouent durablement ? Quelles sont les représentations du sexe, de la maladie, des rapports de genre, qui freinent ou au contraire constituent les ressorts d’une politique de lutte contre le sida ? Dans un contexte où l’épidémie semble ralentir à l’échelle globale, mais où les inégalités demeurent et où certaines populations continuent à être fortement exposées, la prise en compte des aspects sociaux de la maladie compte plus que jamais, y compris lorsque les stratégies testées se basent sur des avancées biomédicales (comme dans le cas de PrEPs).
La prévention biomédicale : entre avancées et aveuglement
La conférence de Paris a permis de mesurer combien le « tournant biomédical » de la prévention (mise à l’épreuve, dans des études scientifiques, du concept de prophylaxie pré-exposition et de l’idée de traitement comme prévention, notamment), a monopolisé les recherches des dernières années. Il suffisait de voir la place occupée par ces thématiques dans le programme de la conférence.
Dans une table ronde intitulée « Socialiser la prévention biomédicale », Gary Dowsett, un chercheur australien, mettait en garde contre la « médicalisation aveugle de la prévention chez les HSH ». Ainsi, c’est le concept même de HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) qui était critiqué, en tant qu’il obscurcit, par un acronyme, la connaissance des identités sociales et sexuelles des hommes concernés. Élargissant le propos à l’ensemble de la lutte contre le sida, on pouvait mesurer, en effet, le poids paradoxal des « slogans » mi-scientifiques mi-politiques tels que « universal access » (désignant l’objectif consensuel d’un accès universel au traitement, au nord comme au sud) ou « Aids free generation » (pour qualifier l’objectif tout aussi louable d’une « génération sans sida »). Derrière ces acronymes, qui résument des réalités scientifiques complexes, il y a des techniques potentiellement transformables en pratiques. Cette session rappelait donc à juste titre l’attention à porter aux pratiques concrètes, au « monde réel » évoqué par Dean Murphy, contre lequel on a trop souvent tendance à troquer des idéaux vides de sens.
Derrière l’évidente facilité du dépistage, des obstacles à franchir
Une session était consacrée au dépistage (Production and Effects of HIV Testing), dans laquelle une chercheuse brésilienne, Eliana Miura Zucchi, s’intéressait aux motivations du dépistage chez les adolescent-e-s. À partir d’un échantillon de 39 adolescent-e-s, cette chercheuse en psychologie sociale posait un certain nombre de problèmes rencontrés par ces jeunes, tels que l’inégalité de genre dans la négociation des pratiques safe. Ce faisant, elle mettait en avant des « scripts » de genre, c’est-à-dire des éléments revenant régulièrement comme déterminants du dépistage. Ainsi, il apparaissait que chez les adolescentes, la suspicion d’infidélité ou l’incertitude du statut sérologique du partenaire pouvait motiver un dépistage, quand, chez les garçons, le statut économique de leur partenaire semblait plus décisif.
Ces différentes motivations en lien avec des inégalités de genre ou de classe pourraient faire l’objet d’une analyse chez les gays, où l’on pourrait sans doute analyser différents types de motivation au dépistage en fonction de la communauté sexuelle, de la classe sociale, ou du type de masculinité de ces hommes. Encore une fois, c’est bien en s’intéressant aux motivations du « monde réel » que l’on parviendra à adapter les messages de dépistage, trop souvent vagues généralistes (y compris chez les gays)
« Qui sont les hommes ’sexuellement aventureux’ ? »
Terminons, dans le même esprit, par la mention d’une recherche de Garrett Prestage, qui résumait sa question de recherche par : « Qui sont les hommes « sexuellement aventureux » ? ». Son étude, basée sur un questionnaire en ligne rempli par 1365 hommes australiens gays ou bisexuels déclarant des pénétrations non-protégées récentes, donne un certain nombre de résultats. Ainsi, ces hommes semblent avoir ces relations non-protégées à la fois pour des raisons de « sensations » (premier motif invoqué), mais aussi parfois dans une « recherche du risque » plus ou moins directement exprimée. Parmi les facteurs associés à la prise de risque (mais indépendants entre-eux) : le fait d’être attiré par le BDSM, de rencontrer ses partenaires sur internet, d’avoir des fellations avec éjaculation ou de pratiquer l’anulingus. Cette recherche prometteuse n’en était pas moins frustrante, car ne permettant pas d’établir l’interdépendance éventuelle de facteurs de risques, et concluant au constat que les facteurs de risque mis en évidence pouvaient correspondre à une grande diversité de profils socio-sexuels.
